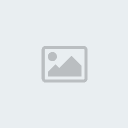| | | La novlangue du néo-libéralisme |  |
| | | Auteur | Message |
|---|
FleurOccitane
Rang: Administrateur
Nombre de messages : 5959
Localisation : Toulouse
Date d'inscription : 30/04/2005
 |  Sujet: La novlangue du néo-libéralisme Sujet: La novlangue du néo-libéralisme  Dim 9 Oct à 14:58 Dim 9 Oct à 14:58 | |
| - Citation :
La novlangue du néo-libéralisme
 Dans son célèbre roman de politique-fiction, 1984, Georges Orwell nous donne à voir combien le pouvoir s'établit et se maintient toujours à travers le contrôle qu'il exerce sur le langage, sur la capacité à imposer l'usage de certains mots ou de certaines expressions, à fortiori de certains slogans, tout en en interdisant l'usage d'autres. Le tout aboutissant à la création d'une nouvelle langue qu'il appelle novlangue C'est que les mots sont rien moins qu'innocents : chacun véhicule une ou plusieurs pensées, idées toutes faites ou présupposés subtils ; et chaque pensée est un acte en puissance C'est dire qu'à travers les mots, ce sont aussi des comportements et des attitudes en définitive que l'on fait naître, que l'on prescrit ou proscrit selon le cas. Dans son célèbre roman de politique-fiction, 1984, Georges Orwell nous donne à voir combien le pouvoir s'établit et se maintient toujours à travers le contrôle qu'il exerce sur le langage, sur la capacité à imposer l'usage de certains mots ou de certaines expressions, à fortiori de certains slogans, tout en en interdisant l'usage d'autres. Le tout aboutissant à la création d'une nouvelle langue qu'il appelle novlangue C'est que les mots sont rien moins qu'innocents : chacun véhicule une ou plusieurs pensées, idées toutes faites ou présupposés subtils ; et chaque pensée est un acte en puissance C'est dire qu'à travers les mots, ce sont aussi des comportements et des attitudes en définitive que l'on fait naître, que l'on prescrit ou proscrit selon le cas.
Cela vaut aujourd'hui pour la manière dont la classe dominante continue à dominer. Parmi les conditions qui ont assuré, au cours des deux dernières décennies, le succès de son offensive néo-libérale, destinée à renforcer sa domination et aggraver son exploitation, figure en effet la mise en circulation, par de multiples biais, parmi lesquels comptent évidemment au premier chef les médias, d'un langage spécifique: des mots, des expressions, des tournures de phrase, etc, progressivement passés dans le langage courant Ce langage est destiné, selon le cars, à faire accepter le monde tel que les intérêts de la classe dominante le façonnent en gros comme dans le détail; ou à désarmer ceux qui auraient tout intérêt à lutter contre ce monde pour en faire advenir un autre, en le rendant incompréhensible, en répandant un épais brouillant sur les rapports sociaux qui le structurent et qui en déterminent le cours; ou tout simplement encore en rendant inutilisable tout autre langage, d'emblée critique à l'égard du monde existant
Sous la rubrique « la novlangue du néo-libéralisme », « A Contre Courant » se propose de passer régulièrement au filtre de la critique les mots clefs de cette langue qui enseigne la soumission volontaire au monde actuel, en le faisant passer pour le meilleur aces mondes ou, du moins, le seul monde possible En espérant ainsi permettre à tous ceux qui subissent ce monde et éprouver comme une prison de se (réapproprier un langage adéquat à leurs propres intérêts et aux combat pour s'en libérer. Et la première édition de cette rubrique sera consacrée au maître mot de cette novlangue : le marché.
LE MARCHE
Au sein du panthéon du néolibéralisme, le marché occupe en effet la première place. Au sein de cette idéologie, il constitue en fait un véritable fétiche. Ce fétichisme ayant essentiellement pour effet et fonction de travestir les rapports de production sur lesquels repose le marché.
Le fétichisme libéral du marché
Le fétichisme est l'attitude qui consiste pour des hommes à conférer aux résultats de leur propre activité, résultats matériels (par exemple les produits de leur travail), résultats institutionnels (par exemple une règle sociale ou l'État), résultats immatériels (par exemple une image ou une idée, celle de dieux ou de Dieu), une puissance surhumaine voire surnaturelle qui les domine jusqu'à les écraser, et dans laquelle ils ne reconnaissent plus leur propre oeuvre. Tel est bien le statut que la pensée libérale confère au marché.
Dans son sens premier, un marché est le lieu où se rencontre acheteurs et vendeurs pour procéder à des échanges marchands (cf. la place du marché). Métaphoriquement, au sein de l'économie politique, il désigne un système de rapports marchands, possédant une certaine capacité d'autorégulation du fait de la pression qu'exercent les uns sur les autres acheteurs (porteurs d'une demande) et vendeurs (porteurs d'une offre) ainsi que de la concurrence qui s'établit aussi bien entre acheteurs qu'entre vendeurs.
Les économistes se félicitent ordinairement de cette capacité d'autorégulation du marché, qui lui conférerait une certaine rationalité. Les néo-libéraux vont bien plus loin en faisant du marché le modèle de toute rationalité, que toute activité sociale devrait tenter d'imiter (tout devrait fonctionner à l'image du marché) ou, à défaut, auquel toute activité sociale devrait se subordonner. A leurs yeux, le marché présente en effet deux vertus essentielles.
En premier lieu, non seulement le marché disposerait d'une capacité d'autorégulation qui en assurerait en permanence l'équilibre; mais encore cet équilibre serait optimal, en ce sens qu'il assurerait la conjonction des intérêts particuliers et de l'intérêt général. Dans une «économie de marché», une économie régulée par le marché (comme est censée l'être l'économie capitaliste), chacun n'est tenu que de poursuivre la réalisation de son intérêt particulier, propre, personnel, conformément à la vision individualiste (égocentrique, égoïste) du monde social qui est celle du néo-libéralisme. Et, pourtant, ce faisant, ce dernier affirme que chacun travaille, à son insu et de surcroit, à la réalisation de l'intérêt général: à la réalisation de l'intérêt de tous les autres membres de la société. Du fait de l'équilibre général vers lequel tendraient spontanément les marchés, «l'économie de marché» assurerait donc la conjonction entre les multiples intérêts particuliers et l'intérêt général. Une bonne nouvelle qui ira sans doute droit au coeur de tous les damnés de la Terre.
Dans le livre IV de son ouvrage intitulé Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations (publié en 1776), Adam Smith a livré une formule restée célèbre de cette croyance en la conjonction entre intérêts particuliers et intérêt général, l'image de «la main invisible» du marché. Formule qui a été reprise sous de multiples formes différentes depuis, dans la tradition libérale
«Ce n'est que dans la vue d'un profit qu'un homme emploie son capital à faire voir l'industrie, et par conséquent il tâchera toujours d'employer son capital à faire valoir le genre dindustrie dont le produit promettra la plus grande valeur, ou do»t o» pourra espérer le plus d'argent ou d'autres marchandises en retour (... ) A la vérité, son intention en général n'est pas en cela de servir l'intérêt public, et il ne sait même pas jusqu'à quel point il peut être utile à la société (...) et en dirigeant cette industrie de manière que son produit ait le plus de valeur possible, é ne pense quà son propre gain; en cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui ne rentre nullement dans ses intentions; et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société, que cette fin n'entre pour rien dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société que sil avait réellement pour but d'y travailler. » Ainsi, selon Smith et la pensée libérale en général, le mécanisme du marché, par son caractère autorégulateur et harmonieux - c'est cela qu'il appelle en définitive «la main invisible» - fait de la poursuite égoïste par chacun des échangistes de son seul intérêt particulier la condition et le moyen de la réalisation de l'intérêt général.
Nulle nécessité par conséquent que s'en mêle la main visible du pouvoir d'État. Et c'est là la seconde vertu majeure du marché selon les libéraux. En effet, non seulement l'intervention de l'État n'est pas nécessaire, puisque le marché est censé s'équilibrer de lui-même; mais encore elle n'est pas souhaitable. Car le marché ne peut être autorégulateur qu'à l'expresse condition que rien ne vienne faire obstacle à la concurrence entre les acheteurs et entre vendeurs ni 'à la pression réciproque des uns sur les autres. Toute intervention extérieure dans le jeu de la concurrence ne peut que perturber ce jeu et nuire à l'efficacité réputée de sa règle.
En particulier, toute fixation administrative des prix (par exemple sous forme d'un salaire minimum), toute manipulation de l'offre ou de la demande par des moyens administratifs (contrôle du crédit, redistribution des revenus, constitution d'entreprises publiques fonctionnant en marge des marchés concurrentiels, etc.) est une hérésie économique d'un point de vue libéral. Une pareille intervention, quels qu'en soient les intentions et les motifs, ne peut, selon lui, que se révéler néfaste, voire désastreuse, en perturbant le mécanisme régulateur et harmonieux du marché et en aggravant en définitive les maux qu'elle prétend corriger. L'Etat doit se contenter d'une part, d'écarter tout ce qui fait ou peut faire obstacle au marché (à la libre circulation des marchandises et des capitaux) et à la régulation marchande (par la concurrence): les barrières légales ou coutumières, les privilèges de droit ou de fait, les situations de monopole, etc.; d'autre part, de garantir les instruments de fonctionnement du marché, en l'occurrence la monnaie et le droit (l'exécution des contrats). Autrement dit, d'assurer le cadre monétaire et juridique (éventuellement judiciaire) à l'intérieur duquel le marché peut et doit fonctionner. Et c'est tout.
Le libéralisme tend donc à réduire l'Etat à ses seules fonctions dites régaliennes: battre la monnaie (garantir l'équivalent général monétaire); dire le droit (rendre justice); exercer le monopole de la violence légitime, à l'intérieur (assurer la police) comme à l'extérieur (par la diplomatie et la force armée). L'Etat doit se limiter à être le garant (monétaire, juridique et répressif) du bon fonctionnement des marchés. Et c'est là d'ailleurs toute la vertu du marché selon les libéraux: il nous libérerait de l'Etat, toujours suspect à leurs yeux d'être potentiellement synonyme d'arbitraire ou même de tyrannie.
Soit dit en passant, cela revient malgré tout à reconnaître que le marché n'est pas un mécanisme autosuffisant, puisqu'il lui faut les garanties et l'appui de l'Etat pour établir et maintenir un certain nombre de conditions (externes) de son fonctionnement. En fait, il faut bien d'autres conditions sociales encore au fonctionnement (apparemment) autonome (autorégulateur) des
marchés. Mais le libéralisme les ignore purement et simplement.
[...] http://endehors.org/news/8623.shtml
Dernière édition par le Ven 28 Oct à 17:18, édité 1 fois | |
|   | | FleurOccitane
Rang: Administrateur
Nombre de messages : 5959
Localisation : Toulouse
Date d'inscription : 30/04/2005
 |  Sujet: Re: La novlangue du néo-libéralisme Sujet: Re: La novlangue du néo-libéralisme  Dim 9 Oct à 14:59 Dim 9 Oct à 14:59 | |
| (suite) - Citation :
L'irrationalité foncière du marché
II y a en fait bien d'autres choses que les libéraux ignorent ou, du moins, feignent d'ignorer. Tout simplement parce que, comme tout bons fétichistes qu'ils sont, ils concentrent leur attention sur le résultat (les produits du travail humain dans leurs rapports marchands réciproques) en omettant de scruter et d'analyser les processus producteurs de ce résultat, en l'occurrence les rapports de production qui sous-tendent le marché et qui rendent compte de son existence et de ses limites foncières.
Ainsi commencent-ils par omettre et occulter que le marché présuppose, tout à la fois, la propriété privée des moyens de production; et l'éclatement du procès social de production, de l'activité économique de la société dans son ensemble, en une myriade de procès de travail privés (les différentes entreprises indépendantes ou capitalistes), résultant d'initiatives et d'activités individuelles ou collectives non coordonnées les unes avec les autres et s'opposant dans et par la concurrence, chacun produisant dans son coin en portant le produit de son travail sur le marché en espérant pouvoir l'y vendre. La production sociale ne répondant ainsi à aucun plan d'ensemble, cela ne peut aboutir qu'à des déséquilibres sur le marché (ce qui correspond aux crises, sectorielles ou générale, conjoncturelles ou structurelles), se traduisant selon le cas par des pénuries ou par des excès d'offre, que le marché est certes en état de rééquilibrer mais en vouant régulièrement une partie de la production sociale à la destruction et une partie des producteurs à la ruine.
Ainsi tout marché et sa soi-disant rationalité harmonieuse reposent-ils fondamentalement sur l'aliénation des producteurs: sur la perte de leur maîtrise de leur propre produit, du produit de leur propre activité, qui non seulement leur échappe mais peut se retourner contre eux pour les réduire à la misère. Autrement dit, derrière et dans la pseudo-rationalité du marché se manifeste l'irrationalité de rapports de production dans lesquels le produit commande au producteur et les choses dominent les hommes. Et c'est cette irrationalité qui donne naissance au fétichisme du marché dont les penseurs néo-libéraux sont les grands prêtres.
L'occultation du capital
L'occultation libérale des rapports de production ne s'en tient pas là. L'exaltation libérale des vertus de « l'économie de marché » omet encore de signaler que celle-ci ne se définit pas seulement par le fait que la plus grande part, qui va d'ailleurs en s'accroissant, du produit du travail social prend une forme marchande, devient marchandise pour s'échanger sur le marché; mais encore par le fait que ce sont aussi et même surtout les conditions même de la production qui sont devenues marchandises : tant ses conditions matérielles (les moyens de production: la terre et les richesses naturelles, les outils et les machines, les infrastructures productives socialisées, etc.) que ses conditions humaines (les forces de travail, les capacités physiques, morale et intellectuelles que les hommes peuvent investir dans leurs activités productives). Et que la condition même pour que forces de travail et moyens de production deviennent eux aussi des marchandises est que les producteurs aient été expropriés: privés de toute propriété et possession de moyens de production, réduits à l'état d'individus dépourvus de toute propriété économique hormis celle de leur force de travail; tandis que, inversement, les moyens de production, bien que produits du travail social dans son ensemble, leur font face comme propriété privée d'une minorité de membres de la société. C'est de cette situation d'expropriation seule que peut naître la nécessité pour les uns de vendre leur force de travail et la possibilité pour les autres de l'acheter. Et d'en user, c'est-à-dire de l'exploiter à des fins de valorisation de leur capital.
Ainsi ce que masque l'apologie libérale de «l'économie de marché, mettant unilatéralement l'accent sur la circulation des marchandises et sa soi-disant rationalité, c'est l'expropriation des producteurs qui est la condition même du capital comme rapport de production.
L'irrationalité foncière de cette «économie de marchés ne tient pas seulement au fait que les producteurs y perdent en permanence la maîtrise de leurs produits, dont la ronde infernale les menace constamment de ruine ; mais encore, et plus fondamentalement, au fait que l'immense majorité des producteurs y ont perdu la maîtrise de leurs propres moyens de production, qui servent dans les mains d'autrui comme moyens de leur propre domination et leur propre exploitation. Là encore, le produit domine le producteur, le travail mort (passé, matérialisé dans les moyens de producteur) exploite le travail vivant (les dépenses actuelles de forces de travail).
Le fétichisme néo-libéral du marché est donc une religion barbare dont le dieu caché, jamais dénommé comme tel par lui, n'est autre que !e capital. Une religion qui exalte la soumission (pouvant aller jusqu'au sacrifice) des hommes aux produits de leur propre travail; ainsi que (exploitation (pouvant aller jusqu'à la mort) du travail des hommes par !'intermédiaire des résultats antérieurs de leur travail sur lesquels ils ont perdu toute maîtrise. Une religion qui exalte le vampirisme du capital, cette divinité pétrifiée dans des objets (des moyens de production et des moyens de consommation) ainsi que des signes (des signes monétaires, des titres de crédit et de propriété) qui exige pour rester en vie d'absorber en permanence le travail de centaines de millions d'hommes et de femmes qu'il exploite de par le monde, tout en en vouant autant (ou même plus) à la pauvreté, à la misère et en définitive à la mort parce qu'il n'a pas la nécessité ou la possibilité de !es exploiter tout en les privant (les expropriant) de toute capacité à produire par eux-mêmes de quoi satisfaire leur besoin vitaux.
La conclusion s'impose d'elle-même: le bonheur de l'humanité suppose de renverser et de briser à jamais cette idole et d'enfouir ses prêtres néo-libéraux sous les ruines fumantes de leur temple. Et la première condition d'un pareil geste iconoclaste salutaire est de refuser désormais l'usage des mots et expressions tels que : marché, économie de marché, rationalité de marché, etc., en leur substituant systématiquement ceux de capital, économie capitaliste, irrationalité capitaliste, etc.
Alain Bihr
A Contre-Courant syndical et politique #164 mai 2005
Mis en ligne par libertad, le Samedi 8 Octobre 2005, 21:45 dans la rubrique "Pour comprendre". http://endehors.org/news/8623.shtml | |
|   | | FleurOccitane
Rang: Administrateur
Nombre de messages : 5959
Localisation : Toulouse
Date d'inscription : 30/04/2005
 |  Sujet: La novlangue du néo-libéralisme Sujet: La novlangue du néo-libéralisme  Mar 25 Oct à 18:06 Mar 25 Oct à 18:06 | |
| - Citation :
La novlangue du néo-libéralisme

Sous la rubrique « La novlangue du néo-libéralisme », A Contre Courant se propose de passer régulièrement au filtre les mots clefs de cette langue qui enseigne la soumission volontaire au monde actuel, en le faisant passer pour le meilleur des mondes ou, du moins, le seul monde possible. En espérant ainsi permettre à tous ceux qui subissent ce monde éprouvé comme une prison de se (ré)approprier un langage adéquat à leurs propres intérêts et au combat pour s'en libérer. La première édition de cette rubrique était consacrée au "marché" (ACC n° 184, mai 2005). La deuxième édition, ci-dessous, est consacrée à "la propriété privée".
Propriété (privée !)
Le vaste mouvement social altermondialiste peut d'ores et déjà se targuer d'un certain nombre de victoires. Par l'ampleur et la diversité de ses mobilisations répétées au fil des ans, il est parvenu, entre autres, à tenir en échec le projet d'Accord multilatéral sur l'investissement (AMI) comme à imper dans l'opinion publique européenne le débat sur l'instauration d'une taxe sur les transactions monétaires et financières internationales (taxe «Tobin»). Nous pensons cependant que, sous peine de se trouver rapidement récupéré par l'aile la plus lucide des partisans de l'ordre existant et de décevoir bon nombre de ses membres, il ne peut se contenter de défendre des projets visant seulement à (re)réglementer les échanges désormais mondialisés de marchandises et de capitaux. Car il ne suffit pas de répéter que le monde n'est pas une marchandise, il faut encore comprendre et dénoncer le régime de propriété qui, inéluctablement, tend à tout transformer en marchandises. En un mot, le combat contre le néolibéralisme doit désormais passer à la vitesse supérieure et rouvrir théoriquement et politiquement la question de 1a propriété privée des moyens de production.
Des confusions intéressées
Depuis le XVII le siècle, le droit de propriété constitue l'un des pivots de la pensée politique et juridique occidentale. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en fait, en son article 17, « un droit invidable et sacré, (dont) nul ne peut être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.» C'est là une formulation modérée (que l'on retrouve dans le droit français ultérieur), puisqu'elle pose quand même à ce droit «inviolable» des limites qui ont effectivement été imposées à certains moments de notre histoire. En revanche, à l'instar de la Constitution des Etats-Unis, d'autres constitutions ou ordres juridiques nationaux ont tendu à privilégier l'approche absolue de la propriété défendue par le libéralisme. Celle-ci postule que la propriété des biens ne doit, hormis des strictes exigences d'ordre public, connaître aucune entrave relative à l'usage (usus), à la mise en valeur (fructus) et à (aliénation (abusus).
La sacralisation de la propriété individuelle, aux dépens des différentes formes de la propriété publique et de la propriété sociale (1), repose sur plusieurs confusions grossières. Quant à la nature du bien possédé, en premier lieu : on met en effet sur le même plan à la fois les biens à usage personnel, dont les individus jouissent seuls ou à titre de membre d'un groupe familial ou d'un ménage, et les moyens nécessaires à leur production (terre, immeubles, infrastructures productives, usines et magasins, etc.). A quoi s'ajoute, en second lieu, une confusion bien plus grave encore sur le rapport entre le bien possédé et son possesseur, autrement dit sur le contenu même du rapport de propriété : on met alors sur le même plan la possession individuelle d'un bien (qu'il s'agisse d'un bien de consommation ou d'un outil de travail) qui résulte, à un titre on à un autre, du travail personnel de son propriétaire, et la possession individuelle d'un bien qui résulte, surtout lorsqu'il s'agit d'un moyen de production, de l'appropriation privative de tout ou partie d'un travail social (collectif). Au terme de cette double opération, la possession par un individu d'un logement, fruit de son labeur personnel, est assimilée à la propriété privée de moyens de production - qui peuvent être des systèmes de production ou de communication immenses - résultant de l'accumulation, des décennies durant, des fruits de la coopération de dizaines voire de centaines de milliers de travailleurs salariés. La forme capitaliste de propriété, sous laquelle se réalise la domination et l'exploitation du travail salarié, peut ainsi se donner comme la condition de la liberté personnelle, masquant ainsi son illégitimité fondamentale.
Pareilles confusions masquent mal la formidable contradiction qui gît au caeur de cette appropriation privative du travail socialisé, qui constitue l'essence de la propriété capitaliste. Contradiction que le capitalisme ne cesse de reproduire à une dimension toujours élargie. Le capital socialise le procès de travail, en organisant la coopération des travailleurs à vaste échelle, en divisant les tâches productives entre eux, en accroissant sans cesse la part de travail mort, matérialisé dans les matières et les moyens de travail, par rapport au travail vivant (la dépense immédiate de forces de travail). Si bien que toute marchandise, de la botte de petits pois jusqu'à l'infrastructure productive la plus sophistiquée (une raffinerie pilotée par ordinateur par exemple), est la matérialisation et la sommation d'innombrables actes productifs, répartis dans l'ensemble de l'espace mondial et du temps historique. C'est ce travail socialisé que le capital enferme pourtant dans le cadre de la propriété privée, de sorte que les résultats d'une coopération vaste et complexe sont appropriés par des individus ou des groupes limités.
Cette contradiction est à la racine des crises capitalistes. Celles-ci résultent toujours en dernière instance de ce que trop de travail (travail vivant et travail «mort», cristallisé sous forme d'équipements) a été engagé sous forme de travail privé (d'investissements d'entrepreneurs ou de groupes privés) par rapport à la somme de marchandises que la société peut absorber sous forme de moyens de production et de biens et services de consommation, dans le cadre des rapports capitalistes de propriété et de distribution. Contradiction dont résulte immanquablement à la fois la crise de réalisation (l'impossibilité de vendre tout ce qui a été produit) et la crise de valorisation ((impossibilité de valoriser le capital à un taux suffisant pour permettre et susciter son accumulation continue). [...] http://endehors.org/news/8715.shtml | |
|   | | FleurOccitane
Rang: Administrateur
Nombre de messages : 5959
Localisation : Toulouse
Date d'inscription : 30/04/2005
 |  Sujet: Re: La novlangue du néo-libéralisme Sujet: Re: La novlangue du néo-libéralisme  Mar 25 Oct à 18:07 Mar 25 Oct à 18:07 | |
| (suite) - Citation :
Les formes contemporaines de dictature de la propriété privée
L'un des buts et des résultats majeurs du processus de libéralisation, de déréglementation et de privatisation des deux dernières décennies - processus encore inachevé pour ceux qui ne lui voient pas de limites - a été d'étendre considérablement la sphère de la propriété privée. La contradiction entre la socialisation du travail et l'appropriation privative de ses fruits s'en trouve encore accrue, mais ce n'est pas là le souci du capital ou de ses défenseurs libéraux. La question de la forme de la propriété des moyens de production, de communication et d'échange est devenue une question taboue pour les dirigeants syndicaux et politiques, comme pour la majorité des intellectuels de gauche. Elle ne l'est pas pour la bourgeoisie mondiale. Pour cette dernière, la propriété a une importance stratégique dont ses différentes rampantes nationales et sectorielles ne font pas mystère. Les grands groupes industriels et financiers, les médias à leur service et les institutions internationales du capitalisme, n'ont eu de cesse de lancer campagne sur campagne contre ce qui reste de la propriété publique. Ils réclament et ils obtiennent des gouvernements le démantèlement et la privatisation de tous les secteurs, notamment dans les services, qui échappent à la valorisation directe du capital, et cela même dans les cas où la propriété publique de services publics clefs, précédemment marqués par un sous-investissement chronique, a servi pendant un demi-siècle de soutiens permanents à l'accumulation du capital. Ils se préoccupent donc vivement de l'extension du champ de la propriété privée, de même qu'ils s'intéressent aux formes qui satisferont le mieux les exigences du capital financier, dont des fonds de pension et de placement financier sont aujourd'hui le coeur.
Depuis dix ans, en effet, on assiste au sein de la sphère même du capital privé (et même dans des entreprises qui sont toujours restées privées), à une transformation profonde de la définition même de la propriété, des «droits» qui lui sont afférents (ceux de l'actionnariat devenu tout puissant) et des attentes que les actionnaires pourraient avoir «légitimement» en terme de rentabilité de leurs parts de propriété. Ici la «contre-révolution conservatrice» néo-libérale prend appui sur la revitalisation contemporaine de cette institution très particulière du capitalisme qu'est le marché secondaire de titres (la Bourse). Cette institution garantit aux actionnaires, en deçà des crises financières graves, la «liquidité» de leurs actions, la possibilité de se défaire à volonté de cette fraction de leur propriété qui a pris la forme des parts de telle ou telle entreprise. Les marchés boursiers sont passés en quelques années du statut de marchés où se négocient des titres à celui de marchés où les entreprises sont négociées, échangées, agglomérées ou démantelées. II y a une quinzaine d'années encore, il était de bon ton d'ironiser sur les «jeux de mécanos» des ministères de l'Industrie. Ils ont été dépassés, et de très, très loin, par ceux des marchés boursiers, aussi bien en dimension qu'en démesure et en gaspillages. La propriété des titres étant devenue liquide, les actionnaires estiment que le capital physique (les moyens de production) et surtout les salariés doivent avoir la même «liquidité», la même flexibilité, avec la possibilité d'être jetés au rebus. Et c'est ainsi que le conseil d'administration d'un fonds de pension, largement anonyme, peut décider du jour au lendemain de la restructuration ou de la fermeture de dizaines d'établissements industriels et, à travers eux, du licenciement de centaines de milliers de travailleurs, dans le seul but de «créer de la valeur» pour l'actionnaire.
Comme si cela n'était pas suffisant, le capital financier multiplie les pressions pour faire main basse sur les différentes formes socialisées du rapport salarial, les différents systèmes de protection sociale sur fonds publics, édifiés au cours de décennies passées, notamment en réponse aux luttes des travailleurs visant à s'assurer des protections collectives contre la propriété capitaliste. La transformation des régimes de retraite par répartition au profit de fonds de pension, tout comme les incitations fiscales à développer des formules d'épargne salariale, fournissent deux exemples parmi d'autres possibles de la tentative de s'approprier, sous forme d'assurances privées, dont la maxime est «à chacun selon ses moyens (contributifs)», la part de la richesse sociale, produit du travail social, jusqu'à présent socialisée (redistribuée) sous formes de fonds publics fonctionnant selon le principe «à chacun selon ses besoins». Tandis que ce que vise l'Accord général sur le commerce des services (Agcs), dont la négociation est à l'ordre du jour à l'Omc, c'est, sous couvert de liberté de l'investissement et de l'offre marchande de services privés, la transformation des services publics (notamment d'enseignement et de santé) en marchés accessibles, comme aux Etats-Unis, uniquement à ceux qui ont les moyens monétaires de satisfaire des besoins versité. C'est sur l'ensemble des conditions tant matérielles qu'intellectuelles du procès de production, couvre du travail historique-social de l'humanité, que le capital entend désormais faire main basse en les livrant à l'appropriation privative marchande. Cet objectif tient à la place prise par la science et la technologie (la connaissance comme «force productive directe») dans !a concurrence capitaliste et il a aussi comme ressort la nécessité pour le capital de trouver continuellement de nouveaux champs de valorisation afin de repousser le moment où les crises éclatent. Mais il correspond aussi à l'une des tendances les plus profondes du capitalisme, qui le distingue de toutes les formes d'organisation sociale qui l'ont précédé, à savoir le mouvement qui le pousse vers une appropriation «totale» de l'ensemble des conditions de la praxis sociale, pour faire de ceux-ci autant de médiations de son mouvement de reproduction et de survie(2)
La «protection de la propriété industrielle» est au coeur de la question du prix - expression de leur position de monopole collectif - que les grands groupes pharmaceutiques occidentaux ont voulu imposer aux pays pauvres, dont l'Afrique du Sud, pour l'accès aux thérapies contre le sida, en même temps qu'ils engageaient des procédures pour à obtenir que l'Inde et le Brésil se voient interdire la production et la vente, même chez eux, des produits génériques combattant les effets de la pandémie. Une vaste campagne internationale a été menée, qui s'est ensuite prolongée dans la conférence de l'OMC à Doha. Les groupes pharmaceutiques ont fait de petites concessions, mais la «protection de la protection industrielle» et le régime des brevets n'ont pas été mis en cause, pas plus que leur extension au vivant. I! faut donc en parler ici.
Chaque fois qu'un groupe transnational pharmaceutique appose son brevet sur un médicament, il s'approprie, pour en faire un élément de renforcement d'une position monopoliste et la base d'un flux correspondant de profits et de redevances de royalties de licences, des connaissances scientifiques produites socialement et financées publiquement(3). Le produit breveté est toujours la conséquence à la fois d'une longue accumulation générale de savoirs faire indépendamment du groupe qui brevète et le résultat de travaux précis de chercheurs qui travaillent, sur financement étatique, dans les laboratoires publics et universitaires d'un ou souvent de plusieurs pays, ou alors dans de petites firmes. Le brevet organise et défend juridiquement ce processus de d'expropriation des chercheurs et des pays qui les financent - ou au mieux de paiement de leur contribution à vil prix ou, pour ceux qui sont prêts à se laisser acheter, avec la nouvelle monnaie de singe que sont les stock options. Ce brevet permet ensuite aux groupes oligopolistiques de transformer le savoir social ainsi privatisé en mécanisme d'extraction de flux de rentes et en instrument de domination sociale et politique. En 1942, il n'existait ni aux Etats-Unis ni dans l'écrasante majorité des pays du globe, de brevetage des médicaments(4). La production de la pénicilline inventée par Fleming a pu donc se diffuser très vite et à faible coût et sauver très vite des dizaines de milliers de vies humaines. Cinquante ans plus tard, en revanche, au moment où se finalise le Traité de Marrakech, les Etats-Unis ont pris la tête du lobby des groupes pharmaceutiques pour imposer à l'ensemble des pays membres de l'OMC, quels que soient leurs ressources ou leur niveau de développement, l'adoption dans des délais très courts du droit de la protection de la propriété intellectuelle auxquels même les pays de l'OCDE ne s'étaient ralliés qu'avec énormément de lenteur et de réticences.
Le brevet est l'une des formes de la propriété privée capitaliste dont la légitimité parait la plus contestable, voire inexistante, aux yeux des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui sont attentifs de par le monde aux positions du mouvement social contre la mondialisation libérale. II faut en désigner le sens sans faire de concession. D'autant plus que l'extension internationale actuelle de la protection industrielle aux gènes ou aux séquences de gènes des végétaux et des animaux, dont ceux de l'espèce humaine, heurte les principes juridiques et éthiques et suscite une très forte résistance dans de très nombreux pays. Que représente en effet le brevetage systématique du vivant, si ce n'est une appropriation privative des mécanismes de production et de reproduction biologique qui sont et devrait rester le patrimoine de l'humanité tout entière ? L'UNESCO protège à juste titre des villes et des sites des ravages de la privatisation. Le patrimoine biologique devrait-il être traité différemment sous prétexte que son appropriation privative est potentiellement source d'énormes profits oligopolistiques ? Le processus de soumission au droit de la «protection de la propriété industrielle», donc la privatisation des molécules et des gènes récoltés par les équipes des groupes pharmaceutiques et agro-chimiques dans les pays tropicaux, a pu être été caractérisé comme une «nouvelle étape des enclosures» (Vandana Shiva). Parallèlement le développement d'organismes génétiquement modifiés (OGM), leur substitution plus ou moins forcée aux plants traditionnels dans l'agriculture, traduit un processus analogue, parachevant l'expropriation des producteurs, ici les agriculteurs, à l'égard de la possession et de la maîtrise de leurs propres moyens de production et, partant, de leurs conditions d'existence.
[...] http://endehors.org/news/8715.shtml | |
|   | | FleurOccitane
Rang: Administrateur
Nombre de messages : 5959
Localisation : Toulouse
Date d'inscription : 30/04/2005
 |  Sujet: Re: La novlangue du néo-libéralisme Sujet: Re: La novlangue du néo-libéralisme  Mar 25 Oct à 18:08 Mar 25 Oct à 18:08 | |
| (suite) - Citation :
Arrêter une fuite en avant désastreuse
La propriété privée et les droits qu'elle confère sont au coeur de la crise écologique. Celle-ci s'enracine dans le fait que la valeur d'usage, ici celle des ressources naturelles du globe et la biosphère, n'intéresse le capitalisme que pour autant qu'elle peut servir de support à la valorisation marchande en vue du profit. Elle est la conséquence du productivisme aveugle et à horizon court dont la recherche du profit est porteur et que la domination des investisseurs financiers aggravent encore. C'est la propriété privée du sol, du sous-sol et de leurs ressources qui est le fondement de leur exploitation débridée. Ce sont pourtant des extensions ou des applications de l'appropriation privée qui sont prônées comme offrant la solution à la crise écologique. Ainsi la Convention de Rio (1992) généralement présentée comme une étape importante dans la protection de l'écologie planétaire est en fait un vecteur du renforcement des droits du capital sur la nature. Elle reconnaît certes que les paysans et les communautés ont utilisé et conservé les ressources génétiques depuis des temps immémoriaux, mais elle ne leur accorde aucun droit de gestion ou de propriété sur ces ressources. Sous la pression des Etats-Unis, la Convention exclut une partie décisive de ces ressources localisées dans les banques nationales et internationales de gènes, source de profits pour les groupes alimentaires qui vendent les semences. La philosophie de cette approche a été donnée par l'OCDE : «La préservation des ressources de la biodiversité serait mieux assurés si elles étaient privatisées, plutôt que soumises à un régime de libre accès, dans lequel les utilisateurs pratiqueraient une exploitation à court terme selon le principe un "premier arrivé, premier servi'.. C'est dans ce cadre de «régulation par la privatisation», qu'il faut situer les discussions au sein de l'OMC, dont une préfiguration se trouve dans les conséquences sociales et environnementales désastreuses de l'exemple de l'Accord de Libre-échange Nord-Américain (ALENA) (6).
Les derniers rapports de la commission scientifique des Nations unies établissent que la dégradation de la biosphère a atteint un point tel qu'il est devenu prévisible que pour certaines régions et communautés qui y vivent, situées dans des pays du «Sud» ou de l'ancien «Est», les conditions physiques de la reproduction de la vie en société sont désormais menacées à court terme (entre une et trois générations). Les gouvernements des pays capitalistes développés et les institutions internationales n'en considèrent pas moins que c'est toujours en termes de droits de propriété et de marchés où ces «droits» se négocieraient qu'il faut raisonner. C'est à cela qu'ont abouti en effet les négociations tenues en Allemagne puis aux Pays-Bas consécutives à l'accord de Kyoto (1997). L'émission et la négociation marchande de «droits à polluer», qui ouvriront un nouveau champ à la spéculation financière, ne traduisent pas simplement le choix des Etats-Unis. Le choix de ce qui est présenté comme un simple «outil technique» vient réaffirmer le caractère intangible de la propriété privée ainsi que des droits qu'elle confère de destruction des conditions sociales de reproduction de certaines parties du monde, afin de défendre les privilèges des autres et de faire perdurer un mode de développement dont la filière pétroautomobile est la cheville ouvrière. [...] http://endehors.org/news/8715.shtml | |
|   | | FleurOccitane
Rang: Administrateur
Nombre de messages : 5959
Localisation : Toulouse
Date d'inscription : 30/04/2005
 |  Sujet: Re: La novlangue du néo-libéralisme Sujet: Re: La novlangue du néo-libéralisme  Mar 25 Oct à 18:09 Mar 25 Oct à 18:09 | |
| (suite) - Citation :
Quelques fils conducteurs pour orienter la discussion
De quelque côté qu'on se tourne, l'institution de la propriété privée, dont le libéralisme a accru et continue à étendre l'emprise, aiguise la contradiction entre le caractère social des moyens de production et des ressources naturelles et les effets directs et indirects socialement et écologiquement de plus en plus désastreux de leur appropriation privative. Celle-ci ne fait pas que stériliser le développement des capacités productives des femmes et des hommes qui composent la société - au plan matériel, politique et psychique - mais conduit encore à l'involution de ces capacités en autant de forces destructrices. Ainsi une part très importante de la recherche scientifique et technologique est-elle orientée vers des objectifs militaires ou dirigée vers l'appropriation-expropriation du vivant. Mais c'est aussi la vie quotidienne qui est contaminée. C'est parce que les individus se trouvent prisonniers d'un processus de privatisation poussé à ses extrêmes conséquences, donc privés de toute insertion dans un ordre symbolique collectif, dans un «habitat» imaginaire commun, qu'un nombre grandissant d'entre eux peinent à construire, maintenir et développer leur identité personnelle et, partant, à communiquer avec les autres comme à participer activement à l'appropriation (ou la réappropriation) de leurs conditions d'existence, sous la forme d'un combat politique. Comme aux autres niveaux de manifestation de la contradiction, la privatisation (le repli individualiste) stérilise ici les forces productives (en l'occurrence symboliques et imaginaires) développées et les potentialités de création individuelle et collective ouvertes par la socialisation.
Compte tenu de ces multiples facettes de la question de la propriété, le mouvement contre la mondialisation libérale doit, comme premier pas, lancer dans le respect de ses nombreuses composantes et sensibilités, une discussion collective qui doit s'inspirer des principes suivants.
La Terre et l'ensemble de ses richesses, qu'elles soient minérales, végétales ou animales, doivent âtre tenues comme le patrimoine commun et indivise de l'humanité tout entière, présente et à venir. Toute appropriation privative de ces richesses, en tout ou seulement en partie, est fondamentalement illégitime. II ne peut être reconnu tout au plus à toute partie de l'humanité (individu ou collectivité) qu'un droit d'usage sur une partie de ces richesses; droit assorti de l'expresse condition que cet usage ne soit pas préjudiciable au restant de l'humanité, présente ou future. Il faut donc montrer l'illégitimité de la grande propriété privée foncière, dont l'effet est soit de stériliser les terres en interdisant leur occupation (c'est ta cas de grandes parties du Brésil), soit d'en détruire à vive allure les ressources (c'est le cas de la forêt amazonienne). II faut donc aussi appuyer les luttes paysannes visant à se réapproprier la terre. A fortiori faut-il continuer, plus que jamais, à s'opposer à toute tentative d'appropriation privative des -mécanismes de reproduction biologique, à travers le brevetage de séquences du génome des organismes vivants ou la production d'OGM) ; de même qu'à l'établissement d'un marché des droits à polluer. Du côté de ceux qui combattent aujourd'hui la mondialisation libérale, on constate simultanément une forte conscience de l'existence d'un lien entre ces dégradations et la libéralisation et la déréglementation qui mettent le pouvoir économique effectif entre les mains des «marchés», mais aussi une réticence à directement mettre en cause les formes dominantes de la propriété des moyens de production, de communication et d'échange.
En second lieu, la propriété privée ( l'appropriation privative) de moyens sociaux de production (moyens produits par un travail socialisés et ne pouvant être mis en oeuvre que par un travail socialisé) doit également âtre tenu pour fondamentalement illégitime. La propriété de pareils moyens appartient à la société (potentiellement l'humanité dans son ensemble), les travailleurs qui les mettent en oeuvre n'ayant pour leur part qu'un droit d'usage subordonné à cette propriété sociale. Un premier pas consisterait à affirmer la supériorité du droit des travailleurs sur celui des propriétaires-actionnaires et des managers, notamment pour tout ce qui concerne les décisions affectant directement leurs conditions de travail et d'existence. Mais il faut aussi défendre le principe que les questions relatives à la production et à l'usage de ces moyens - les lieux de leur implantation, les choix technologiques pour leur développement - relèvent d'abord de la décision de la société toute entière, et ensuite de celle du travailleur collectif qui en a l'usage productif. La prise des décisions à leur sujet devant emprunter des formes démocratiques renouvelées.(
A fortiori, l'appropriation privée de moyens sociaux (publics ou socialisés) de consommation - les équipements collectifs, les services publics, les fonds socialisés de protection sociale doit elle être tenue pour fondamentalement illégitime. La propriété de pareils biens et services est l'oeuvre inaliénable des communautés socio-politiques (communes, régions, nations, groupes de nations) qui les ont historiquement constitués et auxquelles seules, sous la forme de la délibération et de la décision démocratiques, doit revenir le pouvoir de les diriger et de les administrer.
Deux idées à méditer pour finir. La richesse sociale produite aujourd'hui est le résultat non seulement d'un travail vivant largement socialisé, mais encore du travail antérieurement accumulé sous forme de connaissances scientifiques et de moyens de production qui sont le produit de l'humanité passée tout entière. A ce titre, tout individu a droit à une part de cette richesse. La concrétisation de cette idée peut prendre des formes multiples, concrétisant le vieil adage, « de chacun selon ses possibilités, à chacun selon ses besoins». De ce fait, la totalité du savoir humain, comme plus largement du patrimoine culturel de l'humanité, doit être considérée comme la propriété commune et indivisible de l'humanité. Tout homme et femme doit donc jouir du droit inaliénable à l'usage de ce savoir et de cette culture. Aucun obstacle économique ou politique, ne saurait être dressé sur la voie de cet usage, à l'expresse condition qu'il ne nuise pas au restant de l'humanité. II importe au contraire que tout le savoir humain et ses instruments de production et de diffusion (y compris électroniques) soient versés dans le domaine public et mis gratuitement à la portée de tous. C'est ce qui fonde l'opposition à tous les projets de privatisation du savoir ou de ses modes de diffusion du type qui est en discussion à l'OMC, ainsi que l'exigence de repenser les conditions de la démocratisation de l'enseignement.
Alain Bihr (ACC) et François Chesnais (Carré Rouge)(9)
1 Voir avec des approches différentes quant au sens exact de ces tomes, Yves Salasse, Réformes et révolution propositions pour une gauche de gauche, Contre-faux, Agone, Marseille, 2001 et Robert Castel dans son dialogue avec Claudine Haroche Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi, Fayarol, Pans, 2001.
2 Voir Alain Bihr, La reproduction du capital: prolégomènes à une théorie générale du capitalisme, Cahiers libres, Editions Page deux, Lausanne, 2001.
3 Voir Français Chesnais, La mondialisation du capital, Coll. Alternatives économiques, Syros, Pais, 1997.
4 Voir Mohamed Larbi Bouguerra, Dans «la jungle pharmaceutique », Le Monde Diplomatique, mars 2001.
5 Voir le livre coordonné par Jean-Pierre Berlan et son chapitre sur fa brevetabilité du vivant en particulier, La guerre au vivant: OGM et mystifications scientifiques, Contre-feux, Agone, Marseille, 2000.
6 J. Martinez-Alier Getting Down to Earth : Practical Applications of Ecological Economics, Island Press, Washington, D.C., 1996.
7 Cf Alain Bihr, «Le traumatisme ordinaire » in L actualité d'un archaïsme, Editions Page deux, 1999.
8 Voir sur ce point les propositions de la Fondation Copenic dans sa publication sur l'appropriation sociale.
9 Cet article est une version développée de celui paru sous le titre « A bas la propriété privée» dans Le monde Diplomatique en novembre 2003.
A Contre Courant #167 août 2005
Mis en ligne par libertad, le Jeudi 20 Octobre 2005, 22:48 dans la rubrique "Pour comprendre". http://endehors.org/news/8715.shtml | |
|   | | FleurOccitane
Rang: Administrateur
Nombre de messages : 5959
Localisation : Toulouse
Date d'inscription : 30/04/2005
 |  Sujet: Re: La novlangue du néo-libéralisme Sujet: Re: La novlangue du néo-libéralisme  Ven 28 Oct à 17:21 Ven 28 Oct à 17:21 | |
| - Citation :
La « refondation sociale »
Le projet de «refondation sociale», sur lequel le patronat fait campagne depuis maintenant plusieurs années et qui lui a déjà permis de marquer quelques points contre les salariés, se présente, jusque dans sa terminologie, comme un projet de modernisation des rapports sociaux, et tout particulièrement des rapports de production, qui structurent la société française. Symptomatiquement d'ailleurs, en même temps qu'elle lançait cette campagne, la centrale patronale changeait de nom, le Cnpf se mutant en Medef, Mouvement des entreprises de France, qu'on déclinerait d'ailleurs bien plus justement en «Mouvement des exploiteurs de France».
Car, sous son habit neuf, pour la confection et la promotion duquel les patrons n'ont pas hésité à s'assurer le concours d'un ancien maoïste passé par l'école foucaldtenne (François Ewald), on retrouve les principales doctrines et les pratiques par lesquelles, depuis deux siècles et demi maintenant, la bourgeoisie a cherché à justifier les rapports d'exploitation et de domination qui assurent son existence en tant que classe sociale. Tant il est vrai qu'elle reste elle-même prisonnière de ces rapports et des représentations qu'ils induisent.
1. Le discours de la «refondation sociale» s'alimente ainsi, en premier lieu, à la tétralogie libérale de base: individualité -propriété -liberté -égalité. Pour le libéralisme, aujourd'hui comme hier, l'homme n'existe en effet que sous la figure de l'individu, qui plus est conçu dans une perspective strictement individualiste, c'est-à-dire essentiellement comme une personne privée, séparée des autres et même opposée à eux, qui n'a donc de compte à rendre qu'à lui-même et ne peut ni ne doit en retour compter que sur lui même; en un mot: un être auto-centré et auto-référencé. Foin donc de toutes les solidarités, hormis celles somme toutes limités du réseau familial (j'y reviendrais dans un moment).
Cet individu, livré à lui-même, n'a d'existence et de dignité que pour autant qu'il est un propriétaire. Propriétaire tout d'abord de sa propre personne, de ses facultés physiques, morales, intellectuelles, dont il doit disposer le plus librement possible. Propriétaire par conséquent aussi des fruits de son activité individuelle, de leur accumulation dans le temps, fruits dont il peut faire bénéficier les siens, de même qu'il peut et doit pouvoir bénéficier des fruits accumulés de l'activité antérieure des siens. L'unique et sa propriété: telle est, en caricaturant la formule de Max Stirner, l'horizon indépassable de l'individualisme entrepreneurial et patrimonial qui gît au fond de la pensée libérale.
Quant à la liberté dont doit pouvoir jouir cet individu, c'est essentiellement celle d'échanger son bien contre celui d'autrui, d'acquérir dans l'aliénation (marchande) et d'aliéner son acquisition, pour reprendre la formule de Marx. Dans cette perspective, l'individu n'est jamais aussi libre que lorsqu'il se livre au trafic marchand, en cherchant à y satisfaire ses intérêts personnels.
Dès tors, l'égalité revendiquée par la pensée libérale se réduit à celle des conditions de l'échange et dans l'échange: tous les individus doivent pouvoir librement et également accéder au marché, pouvoir y apporter leur bien à égalité d'obligations et d'opportunités. Qui son capital, qui son travail ou le produit de son travail, qui sa simple force de travail, peu importe, dès lors qu'il a quelque chose à vendre, il pourra aussi acheter. II s'agit donc de la simple égalité juridique qui résulte du contrat régissant l'acte d'échange marchand, comme plus largement de l'égalité de tous face aux conditions générale de l'échange.
Cette égalité formelle peut d'ailleurs parfaitement s'accommoder d'inégalités réelles, d'inégalités de situations socio-économiques, de revenu et de fortune, de pouvoir et de prestige, dès lors que celles-ci ne résultent pas d'un privilège de droit. La contradiction entre les deux (entre égalité formelle et inégalités réelles), qui n'en est d'ailleurs pas une pour le libéralisme, peut s'atténuer en mettant en jeu la notion d'égalité des chances: la loi doit donner à chacun la même possibilité de faire, valoir ses talents (ses aptitudes, ses capacités), de sorte que les inégalités sociales ne soient que la conséquence des différences de talents (intelligence, volonté, ténacité, etc.).
2. Chacun pour soi et le marché pour tous, tel est en définitive le fin mot de la pensée libérale. Les tenants de l'ordre existant se sont cependant très rapidement aperçus que le deus ex machina qu'est censé être le marché est une divinité cruelle; et que sa main réputée invisible est une main de fer qui broie impitoyablement tous ceux qui n'ont rien à vendre, fut-ce seulement leur force de travail; ou qui ne parviennent pas à la vendre, temporairement, durablement ou définitivement: enfants, malades, infirmes, vieillards, etc. Le parti du capital, spontanément libéral, se fait alors volontiers paternaliste, en contrevenant en partie à ses propres principes.
Sans doute, n'en somme nous plus au temps des dames patronnesses; et les braves patrons ne donnent plus guère dans ce patronage qui, dés la seconde moitié du XIXB siècle et quelquefois jusqu'à tard dans le XXe siècle, nous a offert des exemples d'une volonté anachronique de conformer le rapport entre capital et travail à celui entre père et enfants, maître et serviteur, seigneur et serf. Mais le projet de fonds d'épargne salarial, outre qu'il assure aux capitalistes une source gratuite de financement de leurs investissements, n'en est pas moins une manière d'aliéner les salariés à «leurs» entreprises et à «leurs» dirigeants, de les rendre solidaires de ceux qui les exploitent et les dominent, en leur faisant intérioriser l'idée que leur sort est, pour te meilleur comme pour le pire, indissolublement lié aux résultats industriels, commerciaux et financiers de la firme qui les emploient.
En cherchant à transformer chaque salarié en actionnaire de sa propre entreprise par le biais de ces fonds d'entreprise, la «refondation sociale» s'inspire non seulement des principes libéraux (chacun n'étant digne qu'en tant que propriétaire); mais encore de ces pratiques paternalistes qui cherchent à «moraliser les travailleurs»: hier par le biais de l'accession à la propriété de son logement ainsi qu'à d'autres services économiques et sociaux (économat, école, jardin d'enfants, hôpital, asile); aujourd'hui par la constitution d'un petit portefeuille d'actions censé assurer leurs revenus pendant leurs vieux jours. Dans les deux cas, c'est les enfermer dans les rets de l'entreprise-providence.
L'entreprise n'est d'ailleurs pas la seule institution à bénéficier ainsi du transfert de providentialité que la «refondation sociale» projette d'organiser au détriment de l'Etat. Là encore, en parfaite continuité avec le paternalisme d'antan, la famille se trouve, elle aussi, (re)mobilisée et (re)valorisée. Le familialisme a toujours été et restera une dimension constitutive du paternalisme. Car le démantèlement des systèmes publics de protection sociale, l'affaiblissement par conséquent des solidarités impersonnelles organisées par l'Etat entre individus à l'intérieur d'une même catégorie sociale, comme entre catégories sociales et entre générations, ne peut aboutir qu'à renforcer la nécessité et l'importance des solidarités personnelles, essentiellement sur une base familiale. D'ores et déjà les difficultés, qui sont allées grandissantes au cours des deux dernières décennies, d'insertion des jeunes sur le marché du travail, la transition de plus en plus problématique d'une partie d'entre eux du système de formation initiale à un premier emploi stable, n'ont pu être palliées que par une mobilisation accrue des familles, sur le plan monétaire comme sur le plan relationnel. De même, si le chômage de masse et le développement de la précarité n'ont pas fait plus de ravage encore, c'est parce que le filet de protection tendu parle réseau familial (là où il existe) est parvenu à combler les trous de celui offert par un Etat-providence en peau de chagrin. Qu'en serait-il demain si les projets de démantèlement de l'assurance vieillesse et de l'assurance maladie concoctés par le Medef trouvaient à se réaliser? Chacun ne pourrait plus compter, pour faire face aux nécessités et aléas de l'existence, outre ses moyens personnels souvent insuffisants, que sur ce qu'il pourrait s'assurer de solidarité familiale. Et c'est le moment de rappeler combien cette dernière expression sert souvent d'euphémisme masquant un appel redoublé à la disponibilité féminine, les femmes étant les chevilles ouvrières de la providence familiale.
3. Mais les projets de «refondation sociale» comprennent une face plus inquiétante encore, pourtant parfaitement articulée tant avec son culte des vertus de l'individualisme entrepreneurial et patrimonial qu'avec ses rémanences de paternalisme. II s'agit de son discours insécuritaire, qui mêle étrangement l'exaltation de l'insécurité, érigée au rang de vertu et valeur majeures; et sa condamnation, dés lors qu'elle prend la forme d'une atteinte à la propriété des biens et à la liberté des personnes.
Chevalier des temps modernes, l'entrepreneur capitaliste s'enivre volontiers de sa geste conquérante. Il se présente comme cet homme qui n'hésite pas à prendre des risques, à se lancer dans l'aventure de la «libre entreprise», à affronter la haute mer du marché, là où d'autres, frileux et peureux, préfèrent vivre quiètement au port, à l'abri de la protection de l'Etat ou de toute autre forme de régulation collective volontaire. Telle serait la supériorité du premier sur les seconds, supériorité qui justifierait par avance et son pouvoir et ses gains. Et le Medef de fustiger toutes les structures de protection qui permettent à trop de monde de vivre sans risque des «rentes» de l'Etat-providence. Soumettre les hommes, le maximum d'hommes, au risque du marché, tel est un des autres leitmotive du discours de la « refondation sociale».
Mais que le risque se présente sous la forme de l'agression contre les personnes ou contre les biens, et le même discours le considérera comme inacceptable. Ce qui est alors proposé par les tenants de ce discours, c'est ni plus ni moins que de retirer les auteurs de pareils actes ... de la circulation, de les mettre hors du jeu du marché autrement dit, comme Loïc Wacquant a eu l'occasion de montrer sur l'exemple des USA(1), ce pays du libéralisme réellement existant, qui sert de modèle aux promoteurs de la «refondation sociale», le démantèlement de l'Etat social ne peut qu'aller de pair avec le développement de l'Etat pénal: là où la cotisation sociale et la prestation sociale sont renvoyées aux poubelles de l'Histoire, c'est la matraque et la chaise électrique (ou la guillotine) que l'ont (re)met en service. L'exaltation de l'insécurité comme vertu du marché se retourne ainsi nécessairement en phobie insécuritaire, dès lors que l'insécurité marchande suscite la révolte contre le marché lui-même. L'une n'est pourtant que le verso de l'autre: car ce sont précisément les victimes de l'insécurité réputée vertueuse du marché qui se font ordinairement les acteurs de l'insécurité délictuelle et criminelle.
La liberté pour les gagnants, la prison pour les perdants! Telle est en définitive la devise inavouée parce qu'inavouable de tout le discours de la «refondation sociale», dont la force tient moins à sa cohérence formelle qu'à la puissance industrielle et financière de ses ténors qui, en matière d'opinions comme en tout autre, en possèdent ou en contrôlent les moyens sociaux de production. Devise en laquelle éclate leur cynisme foncier.
Cynisme de l'exaltation de l'individualité, alors que les politiques néo-libérales empêchent le plus grand nombre de construire ou d'épanouir leur individualité. Cynisme de l'exaltation de la propriété, alors que le capitalisme repose sur l'expropriation généralisée des conditions tant matérielles qu'intellectuelles de la production. Cynisme de l'exaltation de la liberté individuelle pour enrober des mesures qui ne visent qu'à renforcer davantage encore l'exploitation et la domination capitaliste. Cynisme de l'exaltation de l'égalité formelle alors que, sous l'effet des politiques néo-libérales, les inégalités se sont (re)mises à croître sur tous les plans. Cynisme du projet des fonds de pension qui, sous couvert de pseudo problèmes démographiques, ne vise qu'à ouvrir de nouveaux champs à la valorisation du capital financier. Cynisme de l'exaltation des risques soi-disant assumés par les capitalistes, alors que ce sont quotidiennement les travailleurs licenciés et les populations prises en otage par des installation industrielles polluantes et menaçantes qui les encourent réellement tous les jours. Cynisme de la de «rentier» à une époque où la finance met le monde entier en coupe réglée pour assurer leurs rentes aux actionnaires.
Mais ce cynisme n'étonnera en définitive que ceux qui ignorent que la domination s'accompagne toujours du mépris des dominés par les dominants. Les autres, avertis à ce sujet, se trouveront au contraire confortés dans leur intime conviction de la nécessité d'une «refondation sociale» d'un tout autre ordre et d'une toute autre nature. Celle qui, en abolissant conjointement et le capital et le travail salarié, serait précisément destiné à supprimer, avec la domination de l'homme par l'homme, le cynisme qui en fournit le discours d'accompagnement et de légitimation.
Alain Bihr
1 Loic Wacquant, Les prisons de la misère, Raison d'agir, 1999
A Contre Courant #168 septembre 2005
Mis en ligne par libertad, le Vendredi 21 Octobre 2005, 23:21 dans la rubrique "Pour comprendre". http://endehors.org/news/8722.shtml | |
|   | | FleurOccitane
Rang: Administrateur
Nombre de messages : 5959
Localisation : Toulouse
Date d'inscription : 30/04/2005
 |  Sujet: Re: La novlangue du néo-libéralisme Sujet: Re: La novlangue du néo-libéralisme  Mar 28 Fév à 18:40 Mar 28 Fév à 18:40 | |
| - Citation :
La novlangue du néo-libéralisme: La réforme
«La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner sans cesse les instruments de production, ce qui veut dire !es rapports de production, c'est-à-dire l'ensemble des rapports sociaux. Le maintien sans changement de l'ancien mode de production était, au contraire, pour toutes lies classes industrielles antérieures, la condition première de leur existence. Ce bouleversement continue de la production, ce constant ébranlement de tout le système social, cette agitation et cette insécurité perpétuelles distinguent l'époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tous les rapports sociaux, figés et couverts de rouille, avec leur cortège de conceptions antiques et vénérables, se dissolvant ; ceux qui les remplacent vieillissent avant d'avoir pu s'ossifier: Tout ce qui avait solidité et permanence s'en va en fumée, tout ce qui était sacré est profané, et les hommes sont foncés andin d'envisager leurs conditions d'existence et leurs rapports récite avec des yeux désabusés.»(1)
Dans ce célèbre passage du Manifeste du parti communiste, Marx et Engels soulignent une des caractéristiques majeures du mode capitaliste de production, qui le distingue fortement des précédents: il ne peut se reproduire sans se transformer en permanence; le maintien de ses rapports constitutifs fondamentaux passe par l'ébranlement continuel de tout l'édifice social qui en résulte.
Les raisons de cette instabilité permanente et généralisée ne sont pas indiquées ici par Marx et Engels. Ils s'en sont cependant expliqués par ailleurs; et elles se laissent au demeurant aisément deviner. II s'agit, d'une part, de la lutte des classes qui oppose le capital au travail salarié et dont l'enjeu est l'extorsion par le premier au second du maximum de surtravail sous forme de plus-value. A quoi se surajoute, d'autre part, la lutte entre les différentes fractions de la bourgeoisie, comme entre les capitalistes individuels (la concurrence intercapitaliste), dont l'enjeu est la répartition entre eux de ce butin collectif. C'est notamment la résistance opposée par les travailleurs à leur exploitation (leurs luttes pour réduire la durée et l'intensité du travail et pour augmenter leur niveau de vie) quia constamment obligé les capitalistes à bouleverser la base technique et sociale des procès de production et, par suite, de proche en proche, tout l'édifice social.
II faut avoir présent à (esprit cet arrière-plan si ion veut comprendre les raisons des transformations qui ont affecté le sens de ce mot aujourd'hui galvaudé par le néolibéralisme, comme tant d'autres : !a réforme. Car on saisit immédiatement, d'une part, que la réforme est te mode de permanence propre au capitalisme; mais aussi, d'autre part, que le contenu et l'orientation dominante des réformes dont se nourrit la reproduction du capital dépendent fondamentalement du rapport de forces entre capital et travail salarié.
Réforme et révolution
Au tournant du XXe siècle, au sein des organisations politiques fédérées au sein de la IIe internationale social-démocrate (au sens que ce terme possède à l'époque) s'est déroulé un vif débat opposant réformistes (alors qualifiés encore de « révisionnistes s) et révolutionnaires. Selon les premiers, le socialisme pouvait se construire progressivement, au sein même du capitalisme, à travers un certain nombre de réformes plus ou moins radicales (appelées par la suite «réformes de structure»), telles que la nationalisation des grands groupes industriels et financiers, la municipalisation du sol (pour mettre fin à la spéculation foncière), (encadrement du crédit, ta réglementation du rapport salarial par les conventions collectives et la législation du travail, (institution d'un appareil public de protection sociale, etc. Pour les seconds, au contraire, seule. une rupture révolutionnaire, impliquant notamment l'expropriation de la bourgeoisie et des propriétaires fonciers ainsi que la réappropriation par les travailleurs des moyens sociaux de production, le tout dans le cadre d'une dictature du prolétariat, pouvait engager la société sur la voie du socialisme.
Après 1914 (l'éclatement de la Première Guerre mondiale) et surtout après 1917 (la révolution en Russie, la prise du pouvoir par les bolcheviques et l'établissement du soi-disant régime soviétique), le débat a continué à opposer social-démocrates réformistes, partisans de la recherche de formules de compromis entre grand capital et mouvement ouvrier organisé, et léninistes (de toutes obédiences) partisans de la construction de régimes dont l'URSS représentaient, peu ou prou, le modèle. Les premiers ont fini par l'emporter sur les seconds lorsque, à partir des années 1930, dans un contexte de dépression économique profonde, de faillite idéologique du libéralisme classique et d'affrontements entre démocraties parlementaires et régimes fascistes, les luttes de classes ont abouti, dans l'ensemble des Etats capitalistes développés, au compromis fordiste.(2) Pour prix de son renoncement à la lutte révolutionnaire, le prolétariat européen et nord-américain se voyait garantir le plein emploi, la réduction de son temps de travail, la croissance de son pouvoir d'achat et l'annexion à une consommation marchande sans cesse étendue, une socialisation de la protection sociale de l'enfance, de la maladie, de l'infirmité, de la vieillesse, etc. La réforme devenait ainsi synonyme de conquêtes par les travailleurs d'acquis sociaux, par le biais de leurs organisations syndicales et leurs représentants politiques social-démocrates, même si ces derniers pouvaient quelquefois (notamment en France) continuer à développer une idéologie et une phraséologie révolutionnaire, promettant la «rupture avec le capitalisme» à la première occasion qui leur serait donnée d'exercer le pouvoir d'Etat.
Bref, qu'elle ait été conçue comme une fin en soi, devant garantir l'amélioration continue des conditions d'existence des travailleurs dans le cadre désormais intangible du capitalisme ou qu'elle ait été conçue comme autant d'acquis destinés à faire évoluer le rapport de forces en faveur de travailleurs, jusqu'à rendre l'indispensable rupture révolutionnaire possible, la réforme était conçue par les frères ennemis du mouvement ouvrier comme quelque chose d'éminemment positif. Evaluation en définitive partagée par la partie la plus éclairée de la grande bourgeoisie, comprenant que ces réformes social-démocrates allaient, en définitive, en dépit des apparences, dans le sens de ses intérêts les plus fondamentaux, en assurant la perpétuation des conditions de sa domination, non seulement sur les travailleurs mais sur les autres fractions ou couches de la classe dominante, tout comme sur les autres classes possédantes. En somme, sous la dénomination vague de «progrès social», la réforme faisait consensus entre la quasi totalité des forces sociales en présence.
Réforme et contre-révolution
C'est sans doute ce qui a incité cette même fraction hégémonique de la classe dominante (le grand capital) à se saisir de ce terme pour masquer le sens réel des transformations socio-économiques qu'elle a entreprises, à partir de la fin des années 1970, dans un contexte historique très différent. Contexte caractérisé, d'une part, par une nouvelle et très profonde crise économique mondiale du capitalisme, dans laquelle celui-ci est entrée à partir du début des années 1970 et dont il n'est toujours pas sorti ; d'autre part, par une rapide transnationalisation du capital, destinée sinon à résoudre cette crise, du moins à s'y adapter autant que possible, en en faisant payer le prix aux travailleurs, non seulement dans les Etats capitalistes développées, mais sur toute la planète.
Pareille transnationalisation passe par la destruction, tantôt rapide et brutale, tantôt lente et progressive, de bon nombre des acquis de la période antérieure, autrement dit des réformes entreprises et conduites dans le cadre du compromis fordiste. Qu'il s'agisse de démanteler la réglementation légale et conventionnelle du rapport salarial, de manière à flexibiliser et précariser toujours davantage les formes et les conditions d'emploi aussi bien que de rémunération salariale; ou de démanteler les systèmes socialisés de protection sociale face à la maladie (assurance maladie) ou face à la vieillesse (l'assurance vieillesse) pour leur substituer des formes d'assurance privée, sans doute fructueuses pour le capital financier mais désastreuses pour tous ceux qui ne peuvent pas se les payer et même éventuellement pour ceux qui peuvent se les payer (quand les capitaux financiers en questions font faillite ); ou qu'il s'agisse encore de soumettre de la manière la plus directe le système de formation initiale et continue aux impératifs étroits du capital, en le transformant lui-même en une branche de la production capitaliste.
Toutes ces «réformes», d'inspiration néo-libérale, constituent désormais (agenda de la quasi totalité des gouvernements de la planète. Evidemment impopulaires, puisque destinées à liquider bon nombre des acquis antérieurs des travailleurs, elles ne peuvent pas se justifier seulement par !a soi-disant nécessité qui présideraient à leur introduction; par exemple par les contraintes de la mondialisation. Pour se légitimer, il leur faut encore convaincre les présentes et futures victimes de ce qu'elles préparent des lendemains qui chantent, que le marché universel, non seulement mondial en ce qu'il couvre la planète entière mais encore en ce qu'il englobe toutes les sphères de l'existence humaine et de la réalité naturelle, sera un nouveau paradis sur Terre. Et c'est bien à cette fin que les politiques néo-libérales se parent des oripeaux de la réforme.
Le plus singulier dans cette affaire est sans doute que les derniers à participer à ce marché de dupes ne sont pas les héritiers de la tradition réformiste, les ci-devant dirigeants politiques et syndicaux social-démocrates. Parler de réformes à propos d'une entreprise fondamentalement réactionnaire (au sens propre du terme, les politiques néo-libérales visent par certains de leurs aspects à ramener le salariat à un état historique antérieur aux réformes social-démocrates) voire contre révolutionnaire (en tant qu'elles visent à écraser le mouvement ouvrier, à priver les travailleurs de toute autonomie d'action, d'organisation et de pensée) n'est sans doute pas une opération idéologique trop difficile pour des partis et des hommes politiques de droite, dont l'adhésion à la thématique réformiste n'a été, pendant la période antérieure, qu'opportuniste. Mais la chose est autrement délite pour des organisations, syndicales et politiques, de gauche qui ont fondé toute leur identité historique sur cette même thématique. Continuer à se proclamer social-démocrate et à faire croire que l'on assume l'héritage historique de la social-démocratie comme le font en France Hollande, Strauss-Kahn ou Fabius, en Allemagne Schröder, en Grande-Bretagne Blair, alors que leurs politiques détruisent méthodiquement les acquis du réformisme social-démocrate, c'est évidemment autrement difficile et en définitive casse-gueule. Car ces « réformistes» néo-libéraux qu'ils sont devenus, qui travaillent désormais à défaire ce que leurs ancêtres proclamés ont construit, scient manifestement la branche sur laquelle ils persistent à vouloir s'asseoir.
Alain Bihr
1 Kart Marx et Friedrich Engels, Le Manifeste du Parti communiste dans Karl Marx et Friedrich Engels,, Oeuvres choisies en deux volumes, tome 1, p. 25.
2 Pour une présentation détaillée de ce compromis et de sa dynamique historique, je me permets de renvoyer à Du Grand Soir à l'alternative. Le mouvement ouvrier européen en crise, Editions Ouvrière/ Éditions de l'atelier, 1999.
A contre courant #170 décembre 2005
Mis en ligne par libertad, le Mardi 7 Février 2006, 19:07 dans la rubrique "Pour comprendre". http://endehors.org/news/9568.shtml | |
|   | | FleurOccitane
Rang: Administrateur
Nombre de messages : 5959
Localisation : Toulouse
Date d'inscription : 30/04/2005
 |  Sujet: Re: La novlangue du néo-libéralisme Sujet: Re: La novlangue du néo-libéralisme  Mar 18 Avr à 15:09 Mar 18 Avr à 15:09 | |
| - Citation :
La novlangue du néo-libéralisme : Capital humain
Quelle affreuse alliance de mots ! Comme si le capital, ce monstre froid, cette accumulation de travail mort, qui ne doit de survivre qu'au fait de vampiriser en permanence le travail vivant, de consommer productivement la force de travail de milliards d'individus en broyant leur existence, tandis qu'il en voue quelques autres milliards (quelquefois les mêmes) à la pauvreté et à la misère de la précarité, du chômage et de l'exclusion socio-économique, comme si le capital donc pouvait avoir quoi que ce soit d'humain. Les économistes et sociologues, les technocrates, les hommes politiques mais aussi les simples quidams qui osent user de cette expression disent en fait l'inhumanité de leur conception du monde, dans laquelle tout et tous se réduisent à la seule loi qu'ils connaissent et reconnaissent, celle de la valorisation du capital.
Tous capitalistes, tous entrepreneurs !
Mais qu'entendent-ils au fait par là ? Qu'est-ce que désigne cette expression à leurs yeux ? Tout simplement la force ou puissance de travail des travailleurs salariés :l'ensemble des facultés physiques (force, puissance, endurance, dextérité, savoir-faire), morales (courage, persévérance, conscience morale et professionnelle.), intellectuelles (connaissances générales et spécialisés, imagination et intelligence), esthétiques (goùt, talents), relationnelles (capacité d'empathie, sens de la relation ou de la négociation), etc., que possèdent, à des degrés et titres divers et sous différentes formes, les salariés, et qu'ils peuvent mettre en vente sur le marché du travail et mettre en pauvre dans les innombrables procès de travail (activités productives) dont ils sont les agents. Ceux qui désignent la force de travail comme un «capital humain» entendent ainsi convaincre les travailleurs salariés (ou se convaincre) que chacun d'eux posséderait en fait lui aussi, avec sa force de travail, un «capital» au sens d'un ensemble de ressources, en l'occurrence immatérielles bien qu'incorporées dans sa personne, qu'il lui appartiendrait de valoriser au mieux sur le marché du travail, de vendre au meilleur prix et dans les meilleurs conditions, en veillant à en maintenir et même à en accroître la valeur par sa formation initiale et continue, par son expérience professionnelle, par sa carrière, tout comme par le soin apporté à sa santé, par ses activités culturelles et de loisirs hors du travail, par ses relations personnelles, etc. Autrement dit, dans toutes les dimensions de son existence, chacun devrait se considérer et se comporter comme un centre potentiel autonome d'accumulation de richesses marchandes et monétaires, à l'instar de ce que fait l'entrepreneur capitaliste. En somme, à chacun de se comporter comme un capitaliste dont le «capital» qu'il aurait à gérer ne serait autre que sa propre personne, soit l'ensemble de ses qualités ou propriétés valorisables sur le marché. Tous capitalistes, tous entrepreneurs, voici ce que présuppose et laisse entendre cette formule.
Il suffit de vouloir pour pouvoir
Passons sur le cynisme ou l'inconscience qu'il y a à parler de «capital» (donc de possibilité d'enrichissement) à pros de la force de travail de tous ceux, dont le nombre va grandissant, qui se trouvent réduits à la précarité et au chômage, voire à l'exclusion socio-éconorriique pure et simple. Tout simplement parce qu'ils ne parviennent pas à vendre leur force de travail en tant que marchandise, encore moins à la faire fructifier comme «capital». Et le cynisme est à peine moins éhonté et l'inconscience moins stupide lorsque la formule s'applique à tous ceux qui échangent leur force de travail contre des salaires de misère, ces «travailleurs pauvres» dont les salaires ne suffisent pas à satisfaire leurs besoins vitaux et ceux des leurs et dont le nombre va grandissant sous l'effet du développement des politiques néo-libérales, dans le Nord comme dans le Sud.
Ce cynisme et celte inconscience contribuent, en second lieu, à convaincre les uns et les autres que, s'ils se trouvent au chômage ou dans la galère des emplois précaires à répétition ettou s'ils sont employés au rabais, ils ne le doivent qu'à eux-mêmes, qu'à l'insuffisance de leur mobilisation afin de valoriser leur «capital humain» : c'est qu'ils n'ont pas grand-chose à vendre ou qu'ils ne savent pas le vendre correctement. Se trouvent occultés du même coup toutes les structures qui président à la distribution inégale ou à l'appropriation inégale des ressources matérielles, sociales, culturelles, symboliques dans notre société, qui font que le «capital humain» d'un jeune des milieux populaires des banlieues aura peu de chance de valoir celui d'un jeune issu des milieux aisés des beaux quartiers. Individualiste voire psychologisante, la notion de «capital humain» dissout tous les déterminismes sociaux dans le volontarisme de la mobilisation de soi, que condense la formule «Y suffit de vouloir pour pouvoir».
Une entreprise permanente d'accumulation
Quant à la partie des travailleurs salariés qui ont encore la chance de disposer d'un emploi stable, la même formule contribue à les convaincre que c'est à leur «capital humain» qu'ils doivent cette situation plus favorable. Cela les conduit non seulement à se désolidariser des précédents, mais encore à se persuader qu'il leur faut se mobiliser en permanence pour conserver et accroître ce «capffal humain» si précieux, en transformant ainsi leur existence hors travail, dans toutes ses dimensions, en une entreprise permanente d'accumulation de «capital humain» destiné à se valoriser sur le marché du travail. Et, en les préparant ainsi, du même coup, à culpabiliser('), en s'attribuant à eux seuls la responsabilité des inévitables échecs ou revers de fortune qu'ils vont inévitablement connaître sur ce même marché.
Mais, si chacun est un petit entrepreneur gérant son «capital humain» en le valorisant au mieux sur le marché du travail, c'est alors, en troisième lieu, le mécanisme de l'exploitation capitaliste qui, simultanément, se trouve occulté et qui devient incompréhensible. Car, en tant que gestionnaire d'un «capital humain», le travailleur salarié n'est plus censé vendre au capitalisme une puissance (une force) de travail dont l'actualisation (la mise en oeuvre) par le capitaliste peut former plus de valeur que sa valeur propre, générant ainsi une plus-value pour le capitaliste. II est censé vendre «des services» dont le salaire serait en quelque sorte le juste prix, le strict équivalent monétaire. Nulle possibilité d'exploitation entre entrepreneurs capitalistes; tout juste l'un peut-il profiter de son «pouvoir de marché» plus étendu que l'autre...
Un solide fétichisme
A quoi s'ajoute enfin - et c'est là un quatrième niveau de critique de la formule, de caractère plus théorique, donc plus général mais aussi plus fondamental - que parler de capital à propos d'une marchandise (la force de travail), c'est pratiquer un solide fétichisme, au sens où Marx utilise ce terme. C'est laisser croire que, sous prétexte que le capital est une «Valeur en procès», une valeur capable de se conserver et de s'accroître au cours d'un incessant procès cyclique de production et de circulation marchandes, au cours duquel le capital prend alternativement l'apparence de marchandises et d'argent, toute marchandise (comme la force de travail) ou toute somme d'argent seraient, par elles-mêmes, du capital. Et, du même coup, on occulte à nouveau complètement les conditions qui rendent seules possibles cette valorisation : l'exploitation de la force de travail sous forme du salariat et l'expropriation des producteurs, leur dépossession des moyens sociaux de production, qui sont pourtant les fruits accumulés de leur propre exploitation; de même qu'on occulte la nature même de cette exploitation: l'extorsion de surtravail sous forme de plus-value. Parler de «capital» à propos de ce qui est le contraire même du capital en même temps que son principe générateur, c'est renverser tous les rapports de production capitalistes en les rendant incompréhensibles.
Ainsi, qu'ils le sachent ou non, les promoteurs et usagers de la formule «capital humain» sont soit de parfaits idéologues du capital, occultant et légitimant à la fois ce dernier en tant que rapport d'exploitation et de domination; soit les dupes des précédents.
Alain Bihr
(1) Dans un ouvrage paru en mars 2003 et intitulé «La Morale de la question sociale"
(Code Sodis :9486089 - ISBN : 2-84303-077-3 288 p., 20 E, ) Numa Murard montre
comment les orientations des politiques sociales tendent à rejeter les perdants de la
compétition sociale dans la culpabilité de l'échec personnel et cherche les fondements de cette culture de la culpabilité.
Lire aussi :
* La novlangue du néo-libéralisme : la réforme : http://endehors.org/news/9568.shtml
* La novlangue du néo-libéralisme : le marché : http://endehors.org/news/8623.shtml
* La novlangue du néo-libéralisme : Propriété (privée ! ) : http://endehors.org/news/8715.shtml
* La novlangue du néo-libéralisme : La refondation sociale : http://endehors.org/news/8722.shtml
A contre courant #171 janvier février 2006
Mis en ligne par libertad, le Dimanche 12 Mars 2006, 21:33 dans la rubrique "Actualité". http://endehors.org/news/9853.shtml | |
|   | | Contenu sponsorisé
 |  Sujet: Re: La novlangue du néo-libéralisme Sujet: Re: La novlangue du néo-libéralisme  | |
| |
|   | | | | La novlangue du néo-libéralisme |  |
|
Sujets similaires |  |
|
Sujets similaires |  |
| |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |